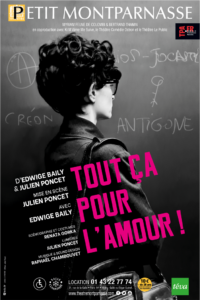Le Monde à l’envers : mission : sauver le monde !
À l’envers le monde ?
Et si pour le remettre à l’endroit, le monde, il nous fallait écouter les secrets d’enfants ? Ceux qui hantent, qui chantent, qui dansent. Qui obsèdent les cœurs et développent les imaginations ? Les secrets joyeux, fous, tendres, éberlués, stratosphériques, douloureux… Mais comment entendre ces secrets, puisque par définition, le secret ne se communique pas, le secret reste secret ? Comment écouter encore et malgré tout, les échos lointains de l’innocence, dans un monde ou les préoccupations d’adultes semblent seules avoir autorités ? Comment se faire comprendre lorsque, déjà loin de l’enfance mais pas encore tout à fait mûrs nous devons admettre que nous ne sommes pas un super-héros ?
Un répondeur téléphonique (auquel Denis Podalydès prête sa voix), joue le rôle du messager. Du super amplificateur ! C’est lui, qui restitue pour notre plus grand plaisir, la parole des enfants qui livrent leurs précieux messages, leurs secrets !
Et déjà les spectateurs, petits ou grands, enfants eux-mêmes, profitent de ces mots pour imaginer un monde ré-enchanté, un monde un peu moins de traviole, un monde un peu plus à l’endroit.

La chorégraphe Kaori Ito et ses trois interprètes s’emparent de ces secrets d’enfants, pour les mettre en espace, en matière, en danse ! Comme un mantra, la phrase de Pina Bausch, « dansez, sinon nous sommes perdus » s’impose au long du spectacle. Tous les thèmes délivrés par ce drôle de répondeur téléphonique d’un autre temps, sont prétexte à danse, à rire, à peine, à joie, à rêve, à révolte, à effroi, à partage… L’enthousiasme et le talent des jeunes interprètes (deux danseuses et un danseur à la générosité contagieuse) nous dépeignent certes, ce monde qui n’est plus droit depuis longtemps, ce monde qui a cessé d’entendre ses émois de culotte courte, de cour de récré, de super petits héros, ce monde dans lequel grandir c’est renoncer parfois, avoir peur souvent, se révolter pourtant, mais qui nous laisse deviner que tout reste possible tant que la part d’enfance de chacun reste en éveil. Le ré-enchantement par la liberté, la fantaisie, le partage… la danse ! Le miracle de la danse qui se fait messagère. La danse qui donne à voir et à comprendre. Avec pour arguments premiers l’envie, l’authenticité, le don ! Merci.
Les enfants ouvrent des billes enchantées et les parents chaussent leurs plus grands sourires comme preuve que tout est encore possible pourvu que ce tout soit partagé.
Pendant les quarante minutes de spectacle notre monde était bel et bien à l’endroit et dansait sur ses deux pieds !

LE MONDE À L’ENVERS
Vu au 104 dans le cadre du festival Séquence Danse
Direction artistique et chorégraphie : Kaori Ito
Interprètes : Morgane Bonis, Bastien Charmette et Adeline Fontaine
collaboration artistique : Gabriel Wong | aide à la dramaturgie : Taïcyr Fadel | composition : Joan Cambon | création lumière et direction technique : Arno Veyrat | design sonore : Adrien Maury | conception téléphone : Stéphane Dardet | aide pour les costumes : Aurore Thibout | regard extérieur : Michel Ocelot
Photos : © Anaïs Baseilhac
Durée indicative : 35/40 min, à partir de 4 ans
À retrouver en tournée :
du 6 au 8 mai 2022 • TOURCOING (FR) • Théâtre du Nord CDN Lille, Tourcoing Hauts-de-France
du 1er au 2 juin 2022 • COGNAC (FR) • L’avant-scène
du 8 au 9 juillet 2022 • VITRY-SUR-SEINE (FR) • Nouveau Gare au Théâtre