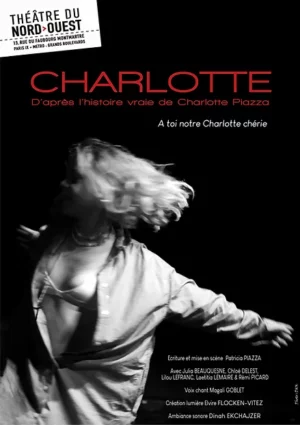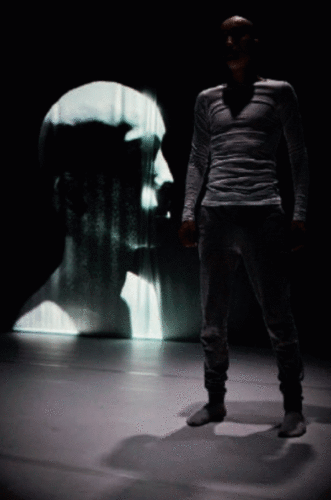Pinocchio (live) #3 : fabuleuses marionnettes humaines
En ce moment, au Points Communs – Nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise, on assiste au merveilleux Pinocchio (live) #3 d’Alice Laloy.
Merveilleux, parce qu’il captive et fascine, mais aussi pour la part de « merveilleux », de magie et d’étrangeté qu’il contient.
« Le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu’il soit volontairement bizarre, car dans ce cas il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu’il contient toujours un peu de bizarrerie, de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c’est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le Beau. Renversez la proposition, et tâchez de concevoir un beau banal ! », écrivait Baudelaire il y a bientôt 2 siècles.
Voilà qui va comme un gant à ce Pinocchio (live) #3, à la beauté déstabilisante et hypnotisante.
Débarrassons-nous tout de suite de l’énigmatique #3 : il s’agit de la troisième version de ce travail, dont la 1ère version avait été créée en 2018 à l’occasion de la Biennale Internationale des arts de la marionnette à Paris et la 2e en 2021 au Festival d’Avignon.
Alice Laloy a rencontré tôt la marionnette et en a fait un support majeur de sa création. Depuis 2023 la compagnie S’appelle reviens qu’elle a fondée voilà 20 ans a posé ses bagages au joliment nommé Bercail à Dunkerque. Par volonté d’ancrer son travail dans les territoires qui l’accueillent, elle a remonté son Pinocchio (live) avec vingt-deux jeunes gens et enfants dunkerquois et hauts-de-franciens, ou françaltiens (gentilés faits-maison faute de mieux…).

Pinocchio, dans l’imaginaire collectif, c’est ce petit pantin de bois fabriqué par un Gepetto en mal de paternité, qui après moults péripéties et mensonges repérables à son nez de bois qui s’allonge s’assagira et deviendra un vrai petit garçon.
Alice Laloy nous emmène à rebours de cette métamorphose, nous faisant assister à la transformation de dix enfants de chair et de vie en dix pantins de plâtre aux yeux figés.
Dix gamins débordant d’énergie ouvrent le spectacle, joueurs, rieurs et chamailleurs. Ils déboulent, envahissent l’espace de sons et de mouvements, repartent, et sur le plateau déserté, laissent la place à la construction d’un curieux laboratoire. Dix Gepetto perchés sur de hauts socques de bois vont monter leurs établis, sous un fracas rythmique de woodblocks et de coups de marteau orchestré par un duo de percussionnistes d’opérette, dans une belle esthétique steam-punk low tech, entre mécanique et système D. Dix gamins catatoniques vont prendre place sur ces établis mi-ateliers de sculpteurs mi-tables de dissection.
On assiste alors à une lente et troublante cérémonie durant laquelle les Gepetto vont, avec tact, soin, patience, et même douceur, en une chirurgie fantasmagorique et angoissante, tenter de faire disparaître les enfants, d’abolir le mouvant et le divers sous l’inerte et le similaire. Vingt-deux interprètes en équilibre sur la frontière entre l’animé et l’inanimé.
Pourtant, le dissemblable résiste, s’obstine : tous uniformisés, tous standardisés, blancs de peau bleus d’iris blonds de cheveux, tous vêtus comme des petites poupées dans leurs boîtes, tous muets regard figé, et pourtant, chacun son relâchement du corps, chacun son abandon, chacun son mutisme, chacun sa façon de s’absenter.
Le long nez de Pinocchio fait une apparition clin d’œil, effilé et dangereux comme une aiguille.

L’ouïe est chahutée de bruitages et musiques grinçant cliquetant, l’odorat même est sollicité par l’odeur du talc humide vaporisé sur les enfants pour les blanchir.
La séquence peut être dérangeante, en tout cas fait naître en chacun questions et réflexions, interrogeant des pulsions d’emprise et de manipulation, même, littéralement, de réification, une volonté de normalisation à la limite de l’eugénisme – tous ces bambins parfaits, à la peau pâle, dociles et dépendants…
On admire le travail magnifique qu’a fait Alice Laloy avec sa troupe, homogène dans sa remarquable disponibilité, dans sa belle précision. La prestation des enfants est particulièrement incroyable, on imagine la confiance qu’elle a dû obtenir d’eux pour qu’ils s’investissent dans ce travail si exigeant. Ils offrent une performance extrêmement aboutie, rigoureuse et puissante. Une passionnante création musicale métisse sons bruts, circassiennes percussions en live et composition électro obsédante et étoffe encore la matière du spectacle.

Pinocchio, pantin de bois, garde une sauvagerie de la forêt d’où vient son bois, désobéissant et méchamment farceur, et gagne son statut d’humain en se pliant aux règles de la société, en se conformant. Ici, autre chose se joue. Sous les faux yeux aux pupilles écarquillées que les Gepetto leur ont posés, les enfants ont les paupières fermées : peut-être, sous ces paupières closes, opposent-ils des rêves au cauchemar dans lequel les adultes semblent vouloir les enfermer ? Peut-être est-ce dans ces rêves qu’ils vont se débarrasser de leur rigidité de pantin ? ou peut-être est-ce dans le mouvement qu’ils se redécouvrent, reprennent possession de leur souplesse et de leur joie.
Dans une saisissante chorégraphie orchestrée par sa soeur Cécile, Alice Laloy leur et nous offre un final libérateur, salutaire bouffée d’air et d’espoir après cette performance singulière, intense et troublante. Un spectacle rare. À voir en famille, à partir de 8 ans.
Marie-Hélène Guérin

PINOCCHIO (LIVE) #3
Un spectacle de la Cie S’Appelle Reviens
Conception, mise en scène Alice Laloy
Composition sonore Éric Recordier
Chorégraphie Cécile Laloy assistée de Stéphanie Chêne
Scénographie Jane Joyet
Avec Alice Amalbert, Mathilde Augustak, Matthias Beaudouin, Étienne Caloone, Ashille Constantin, Roxane Coursault, Robinson Courtois, Nina Fabiani, Léon Leckler, Valentina Papić
et les enfants Charlotte Adriaen, Nohé Berafta, Louna Berafta, Juliette Martinez, Mila Ryckebusch Vandaële, Romane Sand, Elya Tilliez, Eléna Vermersch, Giulio Risaceo, Iness Wilmotte, Éloi Gonsse Martinache pour « l’entrée des enfants » à Dunkerque et à Lille et Edgar Ruiz Suri (remplaçant)
accompagnés par les jeunes percussionnistes Hector Yvrard et Mathis Rebiaï
Création lumière Julienne Rochereau | Costumes Oria Steenkiste, Cathy Launois, Maya-Lune Thieblemont | Accessoires Antonin Bouvret, Benjamin Hautin, Maya-Lune Thieblemont | Régie générale, plateau Sylvain Liagre | Régie son Éric Recordier | Construction des établis Atelier de construction du Théâtre National Populaire
Photographies © Christophe Raynaud de Lage
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Coproductions Points communs – nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise / Val d’Oise I Bateau Feu – scène nationale / Dunkerque I Théâtre de l’Union – centre dramatique national / Limoges I Le Trident – scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin I La Comédie de Clermont – scène nationale / Clermont-Ferrand
La compagnie est subventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec le soutien du Département du Nord, la Ville de Dunkerque et la Fondation d’entreprise Hermès.