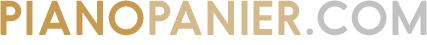La Machine de Turing : « 12 heures, pas une de plus »
Tout le monde connait l’extraordinaire histoire vraie d’Alan Turing. Mathématicien de génie, inadapté à une société conformiste, il déchiffrera l’Enigma, la fameuse machine des nazis, qui leur permettaient de communiquer sans être interceptés par les alliés, tandis qu’homosexuel, dans une société qui les réprouvent, il sera condamné à la castration chimique, et finira par se suicider en croquant une pomme enduite de cyanure. La reine d’Angleterre reconnaîtra son génie et son service, mais seulement en 1993, bien après sa mort. Toute sa vie, la grande question qui le taraudera sera de savoir comment la Nature est programmée.
Alan Turing a porté ses deux secrets toute sa vie et le poids du secret l’a, à tout jamais, isolé. Et c’est bien de la solitude dont nous parle cette pièce. De la solitude d’un homme, si grandiose soit-il, devant taire sous le sceaux du Secret Défense, le déchiffrage de l’Enigma, réussite dont il ne pourra jamais jouir et son secret personnel, celui de son homosexualité, passible de prison en vertu de la loi de 1885, qu’Oscar Wilde aura également à subir.
Alan Turing est un homme seul et traumatisé par la mort de son meilleur ami, son double quasiment, Christopher, mort au seuil de la vie adulte, pour avoir bu du lait frelaté. Alan recherchera ce double perdu dans sa machine, l’ordinateur, qu’il inventera – avant ou après Norbert Wiener ?– et qu’il nommera d’ailleurs Christopher.
Pourtant, malgré un handicap supplémentaire, son bégaiement, remarquablement interprété par Benoit Solès, à fleur de peau, plein d’émotions, de délicatesse et d’enfance, Alan Turing est un homme équilibré, qui va courir tous les jours le marathon, courant tellement vite qu’il n’est qu’à 10 minutes du champion du monde. Il désire aussi, malheureusement pour lui, de petites frappes, comme Arnold Murray, qu’il paye pour ses services sexuels et qui le vole, Arnold Murray qui n’hésitera pas à charger Alan Turing à son procès pour homosexualité et qui, lui, ne sera pas condamné. Pourtant, on imagine qu’Alan Turing et Arnold Murray ont vécu une grande histoire d’amour, en tout cas du côté d’Alan, qui ira jusqu’à se suicider en croquant la pomme comme un pied de nez qu’il enverrait à son amant. Il se suicidera aussi à cause des injections d’œstrogènes, qui lui seront prescrites à son procès, et qui feront de lui quelqu’un d’autre ou peut-être même un monstre et qui ne seront plus tolérables.
Pourtant Alan Turing rompra son silence imposé en se livrant un jour au sergent enquêteur, Mick Ross, qui deviendra presque son ami, joué par Amaury de Crayencour, qui endosse également les rôles d’Arnold Murray et Hugh Alexander, un champion d’échecs. Trois personnages joués avec un grand soin de costumes – par Virginie H – donnant une allure différente à ses trois personnages, à travers des stéréotypes vestimentaires.

Cette pièce n’est pas qu’une biographie, elle mêle à la vie d’Alan Turing une intrigue et un questionnement éthique, qui nous tiennent en haleine et qui font qu’on a véritablement affaire à une histoire. Des analepses, des changements d’époque, délicatement agencées par la diffusion d’images, tantôt reconstituées tantôt d’archives – créations vidéo de Mathias Delfau – sur des panneaux, où l’ombre chinoise a également la part belle. Le son – Romain Trouillet – y a sa place aussi, avec, par exemple, le bruit du crénelage de la machine ou la sonnerie stridente indiquant que les travaux de déchiffrage de ces dernières 12 heures sont maintenant vains, qui, comme un métronome, marque la fin de l’espoir, puisque Enigma était recodée toutes les 12 heures par les Allemands et qu’il fallait à Turing recommencer ses recherches, aidé de son fidèle Christopher.
Alan Turing n’est sûrement pas né à la bonne époque à titre personnel comme grand nombre des esprits hors du commun. Vous le découvrirez en allant voir cette pièce au Théâtre Michel, qui ne désemplit pas. Un beau spectacle à la fois didactique et amusant, remarquablement interprété.

LA MACHINE DE TURING
De Benoit Solès
Mise en scène Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et Amaury de Cayencour
Au Théâtre Michel jusqu’au 31 mars 2019, à 21h
Photo Fabienne Rappeneau