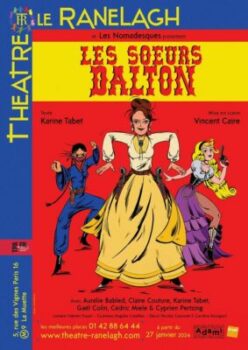Le Conte des contes, d’Omar Porras : Flamboyant remède à la mélancolie
Dans une pénombre timburtonienne, des talons claquent exagérément, tels ceux de la maman aux pieds nus dans l’ouverture du mémorable Petit Chaperon rouge de Pommerat. Clic clac, clic clac, dans un rond de lumière, derrière un micro vintage sur pied, un MC de cabaret introduce the show ! Veste de cérémonie, maquillage expressionniste, verbe vif et langue pointue. C’est le docte docteur Basilio.
Il a été convié par la famille Carnesino à soigner la mélancolie du fils aîné Prince, grâce à sa novatrice et ancestrale thérapie : le soin par administration de contes en inoculation massive.
Il était une fois, dans un château au cœur d’une forêt… car dans les contes, il faut un château et, surtout, une forêt… Il était une fois, donc. Papa leprechaun, Maman vamp hollywoodienne, l’ado Prince abasourdi de mélancolie, la cadette, Secondine, fûtée et disgracieusement binoclarde.
Une famille Adams mâtinée République de Weimar, une brave petite famille pas plus dysfonctionnelle qu’une autre. Et même moins, puisqu’ils ont la sagesse de remettre la santé de leur esprit entre les mains des raconteurs d’histoires.

Basilio, c’est le double contemporain de Gambattista Basile, l’auteur du Cunto de li cunti dont s’inspire ici Omar Porras. Gambatttista Basile, poète du XVIIe s., féru de culture populaire napolitaine, avait collecté une cinquantaine de contes, qu’on retrouvera, quelques générations et régénérations (ou dégénérations…) plus tard, chez Grimm ou Perrault. Ou, encore plus loin, chez Disney. Comme dans ce recueil, les contes seront délivrés par les protagonistes, chacun leur tour, chacun leur ton.
Art du masque (sans masques), commedia dell’arte, grommelot, comédie musicale et death metal, blagues potaches et pyrotechnie, pas de danse, plumes d’autruche et chant lyrique, tout est joyeux, tout est instrument de jeu, tout est bon pour la médication !
Certains tableaux se révèleront plus puissants. Les Cendrillons humiliées et mauvaises au rire de mouette dans leur buanderie de cauchemar, la forêt de tulle qui s’envole sous la neige comme par magie, le duo Secondine au piano, Prince au violoncelle, qui apporte de la tendresse à cet univers gothique, un tango, aussi parodique que séduisant, accompagné par un piano nostalgique et des grésillements de 33 tours râpé, resteront en mémoire.

Les narrations des contes semblent bien étrangement sages dans la dinguerie de cette mise en scène fourmillante d’idées et de drôlerie… peut-être pour évoquer la simplicité et la douceur de ce moment du livre du soir entre parent et enfant.
Mais ces sages lectures ne sont que des respirations entre deux incarnations folles – et parfois furieuses – des contes choisis pour extraire Prince de sa mélancolie.
On reconnaît au passage, sous des habits moins policés que ceux auxquels nous sommes habitués Peau d’âne, Cendrillon, La Belle au bois dormant. Ici, les fillettes sont plus raisonnables et courageuses que les rois, elles ne craignent pas de se salir les mains, les mamans savent expliquer à leurs enfants qu’un viol est un viol – quand bien même la Belle endormie n’en a rien su, et personne ne se nourrit que de légumes, d’amour et d’eau fraîche.
Saluons la magnifique recherche esthétique : costumes et maquillages, fastueux et fantaisistes ; accessoires, poétiques et barbares, notamment les très beaux écorchés dont un bœuf rembrantesque ; impeccable création lumière aux noirs profonds et aux éclairages ciselés ; délicieuse création musicale, où le moelleux de pizzicati de violoncelle peut accompagner suavement les pires bouffonneries gore.
La troupe de comédiens-chanteurs-musiciens a du talent et de l’élégance, le sens du rythme et une précision diabolique, passant avec aisance d’un registre à l’autre.
La somptueuse cuisine, les fourneaux de fonte, casseroles de cuivre et couteaux longs comme des sabres, le fronton de carton-pâte, les tables couvertes de linge blanc et de mets sophistiqués disparaissent petit à petit. Pour faire place à des lieux tout aussi oniriques, de plus en plus abstraits, qui se dépouilleront jusqu’à la nudité du plateau de théâtre, guindes apparentes, carré de loupiotes au plafond, rideau rouge au fond et micro à l’avant-scène, consacrant le lieu en music-hall.

Dans cette fête mi-queer mi-raisin, si les princes et les princesses finissent par tomber dans les bras les uns des autres (après tout, c’est le sort que leur réserve traditionnellement les contes), les travestis sont beaux et sans ridicules, les jeunes gens embrassent serpents et bergers, la mère a des perfections et des splendeurs de drag-queen.
Le manoir familial a disparu, la famille aussi d’ailleurs, place à la fête ! Le Chaperon rouge et le loup ne font peut-être qu’un, les enfants dévorent les parents, au milieu des belles reines de Carnaval perchées sur talon de 20, Prince se sent beaucoup mieux…
Ces contes semblent sombres, mais, et c’est bien mieux, ils sont en fait sauvages, et leur sauvagerie est libératrice !, et, comme Basilio guérit Prince de sa mélancolie, ce joyeusement féroce hommage à l’art du spectacle, cette farce orchestrale et rythmique dont on savoure les outrances et le burlesque avec une jubilation enfantine, soigne les spectateurs de la leur.
À voir en famille, mais pas avant 10-12 ans, les jeunes oreilles pourraient être heurtées par quelques crudités ou cruautés, mais surtout parce que le spectacle est touffu, dense, et – on ne les sent pas passées, mais elles sont là – qu’il dure 2 heures.
Marie-Hélène Guérin
LE CONTE DES CONTES
Au Théâtre des Amandiers – Nanterre, 16 mai — 1 juin 2024
Un spectacle de la compagnie Teatro Malandro
Texte Giambattista Basile
Conception et mise en scène Omar Porras (Teatro Malandro)
Assistanat à la mise en scène Capucine Maillard
Avec Simon Bonvin, Melvin Coppalle, Philippe Gouin, Jeanne Pasquier, Cyril Romoli, Audrey Saad, Marie-Evane Schallenberger
Photos © Lauren Pasche
Adaptation et traduction Marco Sabbatini, Omar Porras
Scénographie Amélie Kiritzé-Topor | Composition, arrangements et direction musicale | Christophe Fossemalle | Chorégraphie Erik Othelius Pehau-Sorensen
Création Costumes Bruno Fatalot | Assistanat costumes Domitile Guinchard | Accessoires et effets spéciaux Laurent Boulanger | Maquillages et perruques
Véronique Soulier-Nguyen | Assistanat maquillages et perruques Léa Arraez | Couture et habillage Julie Raonison
Création sonore Emmanuel Nappey | Re-création lumière Mathias Roche, Omar Porras
Construction du décor Chingo Bensong, Alexandre Genoud, Christophe Reichel, Noé Stehlé
La chanson « Angel » a été composée par Philippe Gouin (Fabiana Medina / Philippe Gouin)
Production / Production déléguée
TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens
Co-production Théâtre de Carouge – Atelier de Genève, Châteauvallon Scène nationale
Soutiens : Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Ville de Renens et autres communes de l’Ouest lausannois, la Loterie Romande Vaudoise, la Fondation Sandoz, la Fondation Leenaards, Pour-cent culturel Migros et de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia