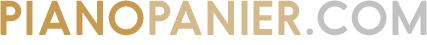Un « Roi Lear » aux atours baroques et punk au Théâtre du Soleil
De la compagnie Théâtre Amer, on avait beaucoup aimé le Peter Pan découvert l’an dernier au Théâtre Paris Villette.
On se retrouve cette fois dans ce lieu magique de la Cartoucherie pour leur nouvelle création.
Des effluves d’encens et de musique baroque accueillent les spectateurs. C’est sur une scène dépouillée que se déroulera la tragédie shakespearienne – un sol terreux, cerné de deux hautes marches courant le long du plateau, qui hiérarchisent verticalement l’espace. En fond de scène se révèlera un cadre de loupiotes, petit théâtre dans le théâtre, castelet de cabaret rougeoyant qui offrira une judicieuse accentuation des comédies de faux-semblants qui se jouent entre les protagonistes.

Un noir profond, un tambourin grave, une rythmique de halètements, un chant de gorge diphonique : l’ouverture a quelque chose de cérémoniel et crée tout de suite une attention particulière.
Le Roi Lear est une tragédie, on s’y marre peu et on y meurt beaucoup. La nouvelle traduction d’Emmanuel Suarez et l’adaptation de Mathieu Coblentz, finement actualisées, l’aèrent toutefois un peu, les allusions à la société contemporaine font réagir les spectateurs mais restent toujours dans le juste mouvement du texte. Quelques intrigues et personnages en moins (notamment les époux des sœurs Goneril et Regane disparaissent, elles portent seules leur statut et leur stature – on pourra peut-être regretter alors qu’elles soient si uniment mauvaises, plus archétypales qu’humaines) en simplifient l’appréhension, on ne se perdra point dans le labyrinthe des trahisons en cascade de ce Roi Lear.
Le roi Lear, c’est ce roi qui va répartir son héritage entre ses trois filles à l’aune de l’expression de leur dévotion filiale. Ce roi fou qui attend de sa fille préférée qu’elle maquille ses mots, ce roi bébé qui veut être cajoler plutôt qu’aimer. Ce roi qui spolie la benjamine et son cœur franc mais sans artifice au profit des deux aînées, grandes gagnantes au concours de la lèche-botterie et de l’hypocrisie.
En miroir des vilénies sororales, Edmond le fils bâtard du comte de Gloucester déchire lui aussi le tissu familial en intrigant contre son frère Edgar, le fils légitime.
On se détruit en famille dans Le Roi Lear, les frères et les sœurs s’entretuent et le cœur des pères lâchent devant le désastre. C’est un temps bien sombre et sans espoir.

Mathieu Coblentz a le sens du spectaculaire, et compose une fresque ambitieuse aux enjeux limpides et à l’humeur obscure.
Sous des lumières soignées, les atours sont baroques et punk, cheap et majestueux – bijoux fantaisie, fourrures, satin, kilts, cuirs rock et maquillages gothiques. Ceux du roi Lear aux allures de roi Soleil tomberont au fur et à mesure de son dénuement social et mental.
Les sept interprètes ont de l’allant, certains passent d’un personnage à l’autre avec beaucoup de souplesse, et il est assez jouissif de les voir déployer d’autres facettes de leur talent dans des rôles très différents les uns des autres, ainsi du fou, d’Edgar et Gloucester incarnés avec brio par les trois sœurs. L’énergie de la troupe laisse peu de place à l’émotion, qui naîtra pourtant – de la puissance des images, de la beauté d’un chant ancien de plusieurs siècles, de la profondeur d’une ombre, de la rage d’un riff de guitare, de la voix de roches éboulées de Jo Zeugma (qui orchestre aussi la superbe création musicale).
On aurait aimé plus de souffle, et sans doute aussi plus de nuances à ce Roi Lear, mais quelques scènes fortes, splendides et puissantes, resteront en mémoire, le geste théâtral est beau et les jeunes spectateurs sont à juste raison enchantés : Mathieu Coblentz ouvre là une magnifique porte d’entrée vers l’univers foisonnant de Shakespeare, avec ce Roi Lear désespéré et fastueux.
Marie-Hélène Guérin

LE ROI LEAR
Un spectacle de la Compagnie Théâtre Amer
À voir à partir de 13 ans
Au Théâtre du Soleil du 22 octobre au 15 novembre 2025
De William Shakespeare
Mise en scène et adaptation Mathieu Coblentz
Traduction Emmanuel Suarez
Jeu et musique Florent Chapellière, Maud Gentien, Julien Large, Laure Pagès, Camille Voitellier, Florian Westerhoff, Jo Zeugma
Scénographie Vincent Lefèvre | Création des costumes Patrick Cavalié | Régie sonore Simon Denis | Régie polyvalente Julien Crépin




 (*)
(*)